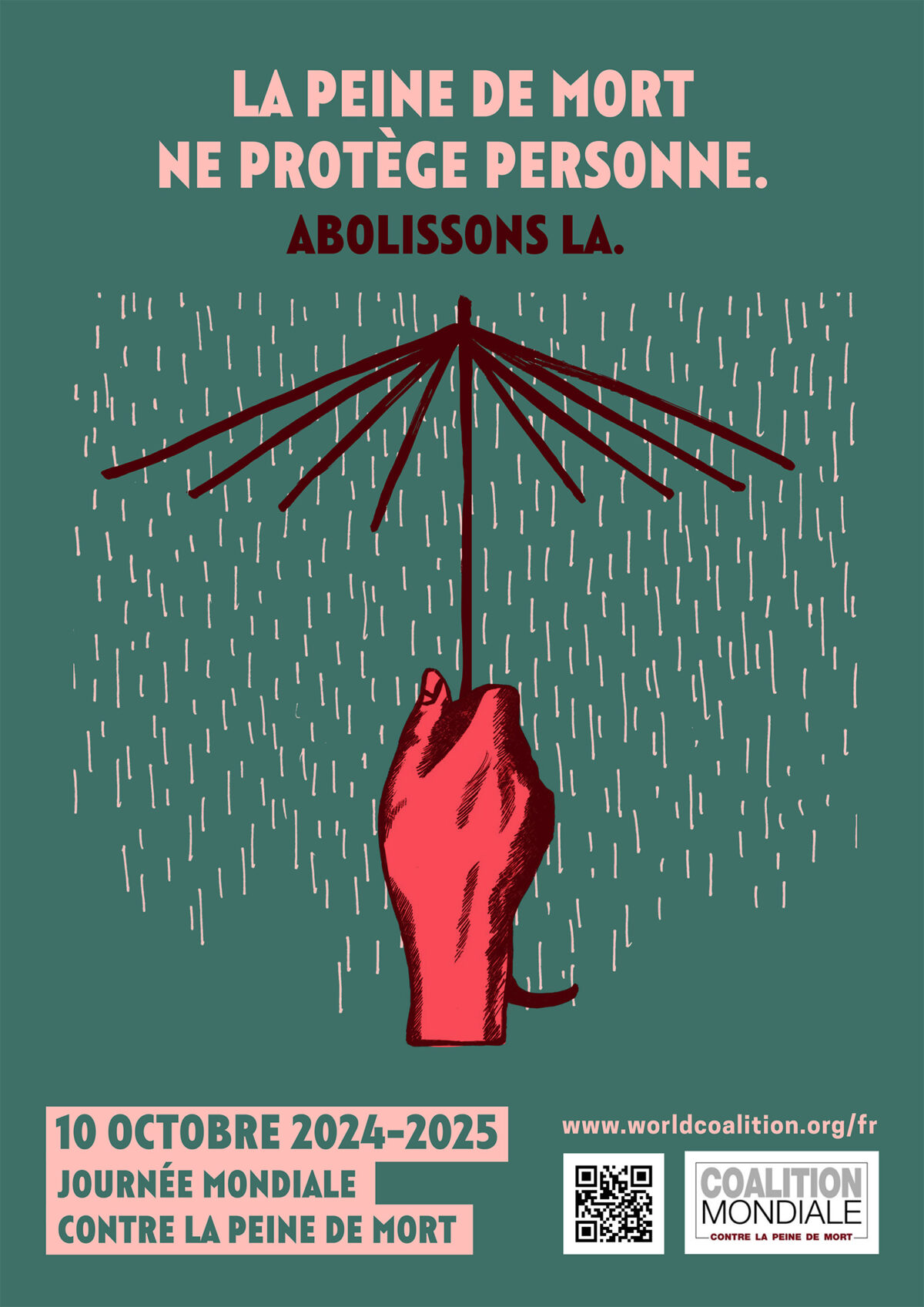L’influence judiciaire sur l’abolition de la peine de mort : Perspectives juridiques mondiales lors du panel biennal de haut niveau
Plaidoyer
Le 25 février 2025, le panel biennal de haut niveau sur la peine de mort s’est tenu au Conseil des droits de l’homme des Nations unies à Genève, sous le thème « Contribution du pouvoir judiciaire à l’avancement des droits humains et la question de la peine de mort. »
Comment le pouvoir judiciaire peut contribuer à l’abolition de la peine de mort
La discussion a rassemblé des intervenants de divers horizons juridiques et gouvernementaux qui ont donné leur avis sur la manière dont le pouvoir judiciaire pourrait contribuer davantage à l’abolition de la peine de mort.
Mme Virginia Mabiza, procureure générale du Zimbabwe, a présenté le contexte historique de la récente décision de son pays d’abolir la peine de mort, en soulignant que ce changement n’était pas seulement juridique, mais aussi profondément sociétal. Elle a retracé l’évolution de la justice au Zimbabwe, notant que les systèmes de justice réparatrice de l’ère précoloniale ont été suivis par les systèmes punitifs de l’ère coloniale, qui ont par la suite cédé la place à une approche postcoloniale axée sur la réconciliation et les droits humains. La Guinée équatoriale a également souligné dans sa déclaration orale que l’abolition de la peine de mort n’est pas un simple acte symbolique, mais une transformation profonde de l’administration de la justice.
M. Ramkarpal Singh, membre du Parlement et ancien vice-ministre au sein des services du Premier ministre de Malaisie, a expliqué comment une décennie de réflexions et d’études a finalement abouti à l’abolition de la peine de mort obligatoire pour certaines infractions en 2023. Il a fait valoir que l’exécution de personnes impliquées dans le trafic de drogue à un niveau hiérarchique peu élevé, souvent pauvres et contraintes de se livrer au trafic, ne permet guère de lutter contre les véritables problèmes, soulignant l’importance de la réinsertion.
M. Hicham El Mellati, directeur des affaires pénales, des grâces et de la détection du crime du Ministère de la justice du Maroc, a présenté une position tout aussi nuancée, soulignant le rôle central du pouvoir discrétionnaire des juges dans le moratoire de fait sur la peine de mort de son pays et appelant à un débat équilibré sur la peine de mort et sa valeur dissuasive. Ce dernier point fait écho à l’appel lancé par l’Espagne aux pays rétentionnistes à envisager un moratoire, plutôt que l’abolition.
M. Dannel P. Malloy, ancien gouverneur du Connecticut (États-Unis) et commissaire de la Commission internationale contre la peine de mort, a souligné que les États américains dotés de lois actives sur la peine de mort ont tendance à avoir des taux de criminalité plus élevés, ce qui met à mal l’argument selon lequel les exécutions ont un effet dissuasif sur la criminalité, tout en insistant sur la responsabilité judiciaire de prévenir les erreurs irréversibles, car « les erreurs se produisent trop souvent« .
Le Haut Commissaire aux droits de l’homme, Volker Türk, s’est fait l’écho d’un grand nombre de ces opinions, en insistant sur les effets néfastes de la peine de mort sur la société. Il a souligné qu’alors qu’une majorité croissante de pays l’abolissent, ceux qui continuent de l’appliquer, en particulier pour des crimes non mortels comme les infractions liées à la drogue, portent atteinte aux normes internationales en matière de droits humains.
Réactions des organisations de la société civile
Divers membres de la Coalition mondiale contre la peine de mort ont pris la parole à la suite de ces interventions, comme Ensemble Contre la Peine Mort (ECPM), qui a souligné que la peine de mort « vise avant tout les catégories de population les plus marginalisées et les plus vulnérables« , ainsi que les minorités et les personnes souffrant de handicaps psychosociaux ou intellectuels.
Les femmes en sont un exemple crucial, comme l’a rappelé The Advocates for Human Rights (TAHR). En effet, leur discours a été l’occasion de souligner le rôle crucial que joue le pouvoir judiciaire dans la lutte contre les discriminations de genre en reconnaissant des circonstances atténuantes telles que les violences conjugales. Des décisions récentes des juridictions américaines, comme celle rendue par la Cour suprême dans l’affaire Andrew v. White, montrent l’importance de la prise en compte des préjugés liés au genre lors des condamnations prononcées à l’encontre des femmes.
Reprieve a également souligné l’importance du rôle des juges au Kenya, où des difficultés persistent malgré des progrès indéniables tels que l’arrêt Karioko Muruatetu rendu en 2017 par la Cour suprême déclarant inconstitutionnelle la peine de mort obligatoire. Toutefois, la Cour suprême a publié en 2021 des lignes directrices visant à rationaliser les processus de révision des peines, mais qui contredisent l’intention de l’arrêt Muruatetu et ont involontairement créé une disparité en limitant la déclaration d’inconstitutionnalité aux seules condamnations pour meurtre. Au 16 février 2025, 177 personnes, dont trois femmes, étaient encore sous le coup d’une condamnation à mort. En outre, l’insuffisante prise en compte de la violence fondée sur le genre reste un problème majeur. Cette déclaration fait écho à celle de la Malaisie, qui souligne que le rôle du pouvoir judiciaire a été renforcé par l’application rétrospective de la loi de 2023 sur l’abolition de la peine de mort obligatoire, car elle donne aux tribunaux la possibilité d’imposer une peine alternative à toute personne ayant été condamnée à mort avant l’entrée en vigueur de la loi.
Dans ce contexte, l’invitation au 9e Congrès mondial contre la peine de mort qui se tiendra à Paris début juillet 2026, lancée par ECPM aux États membres des Nations unies, est bienvenue.